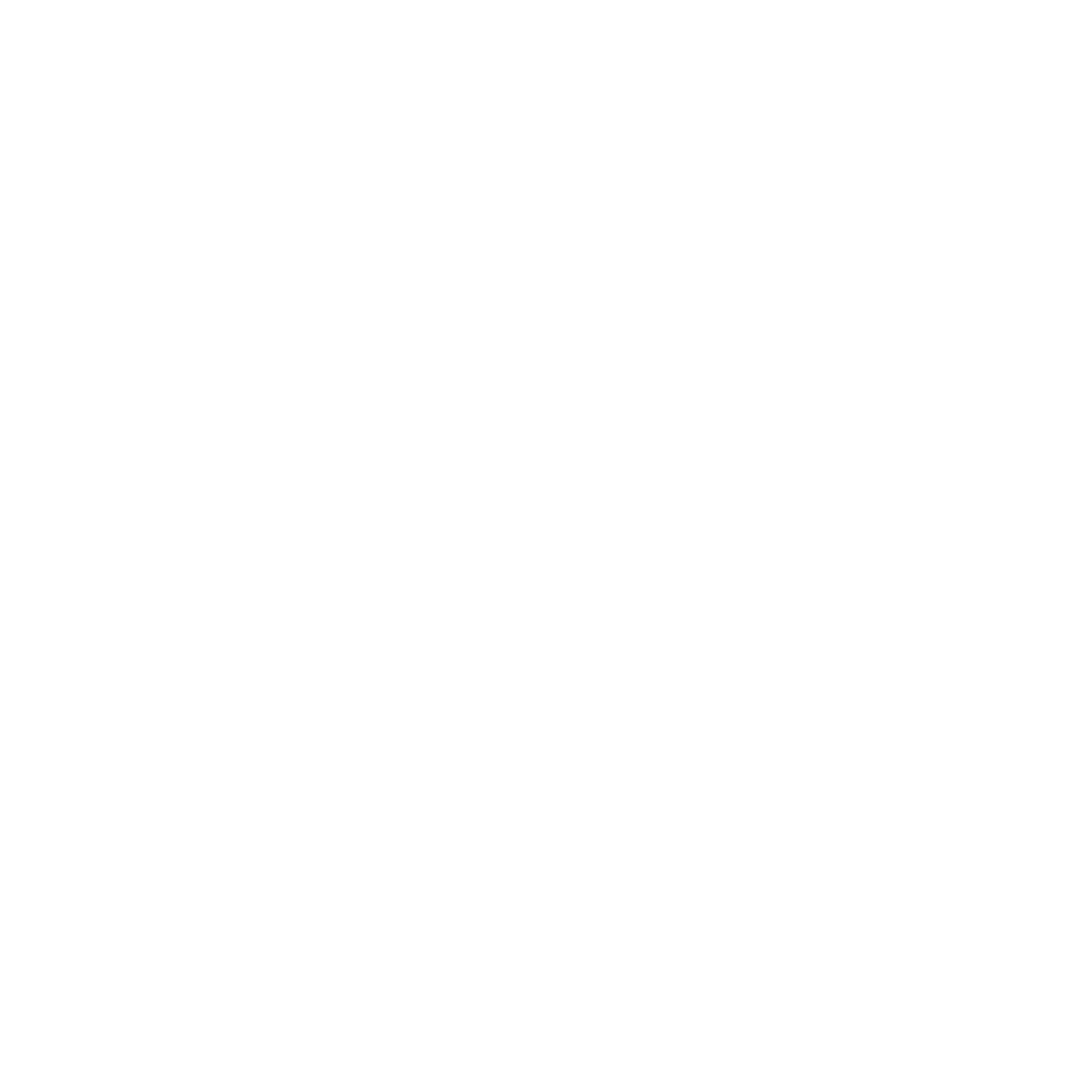METAMORPHOSE D’UNE SCULPTURE EN BRONZE
Du modelage en argile à la sculpture en bronze
Tout commence dans l’atelier, face à l’argile. Alain Choisnet modèle ses œuvres dans une recherche de simplicité et de naturel. Chaque pièce est créée pour dialoguer avec le spectateur et pensée dès l’origine pour devenir une sculpture en bronze.
Lorsque la pièce atteint son aboutissement, elle est confiée à une fonderie d’art. La métamorphose de la sculpture commence alors. Plusieurs savoir-faire spécialisés se succèdent pour mener le modèle vers sa forme définitive. L’artiste peut intervenir à différentes étapes pour préserver l’intention initiale et le niveau de qualité recherché.
De la cire au métal : la fonte à cire perdue
Utilisée depuis des millénaires, la fonte à cire perdue demeure la technique la plus fidèle pour reproduire une sculpture en bronze. Le bronze est un alliage de cuivre et d’étain, reconnu pour sa résistance, sa longévité et sa capacité à restituer les détails les plus fins.
La première étape consiste à réaliser un moule en silicone directement sur la sculpture originale. Lorsque la forme est complexe, le moule peut comprendre plusieurs éléments. Une coque en plâtre ou en résine est ensuite ajoutée pour éviter toute déformation. Ce moule de haute qualité permettra de produire les exemplaires strictement limités de l’œuvre.
L’argile est retirée et l’intérieur du moule est tapissé de cire chaude. L’épaisseur de la cire, de quelques millimètres, correspondra à celle du futur bronze. Des canaux de cire sont ajoutés pour assurer la circulation du métal en fusion et l’évacuation des gaz. L’ensemble est ensuite rempli d’un plâtre réfractaire formant le noyau interne.
Après refroidissement, la sculpture de cire est extraite et soigneusement retouchée. Les lignes de joint sont corrigées et les éventuelles imperfections supprimées. De nouveaux jets et évents sont ajustés avec précision, tandis que de petits clous métalliques maintiennent le noyau parfaitement en place.
La pièce est ensuite recouverte de plusieurs couches de matière réfractaire pour former le moule de potée. Au four, la cire fond et s’évacue lors du décirage, puis le moule durcit autour de 600 °C. Il devient alors suffisamment résistant pour recevoir le bronze en fusion.
La naissance d’une sculpture en bronze
Enterré dans du sable pour résister à la pression thermique, le moule est rempli de bronze liquide porté à environ 1000 °C. Le métal remplace la cire disparue et épouse minutieusement chaque détail de la sculpture. Lorsque le bronze refroidit, le moule réfractaire est brisé : c’est le décochage. Les canaux de coulée, désormais en bronze, sont sciés. Ce moule ne peut être utilisé qu’une seule fois.
Vient ensuite la ciselure, une étape déterminante dans la création d’une sculpture en bronze. Les excédents sont supprimés, les porosités rebouchées, les parties éventuellement soudées, puis la surface est polie. Le bronze retrouve alors sa teinte dorée naturelle.
Le nom de l’artiste, le numéro d’édition, l’année et le cachet de la fonderie sont poinçonnés à la base, garantissant l’authenticité de l’œuvre.
La patine : l’ultime signature du bronze
Riche en cuivre, le bronze évolue naturellement avec le temps. Pour contrôler cette évolution, la sculpture est patinée à chaud. Les solutions appliquées réagissent avec le métal chauffé et créent une palette de nuances allant des bruns profonds aux noirs satinés, parfois jusqu’aux verts ou aux bleus subtils. La couleur finale dépend de l’oxydant utilisé et de la température atteinte.
Une fine couche de cire ou de vernis est ensuite appliquée pour protéger la patine et fixer les teintes. Après un dernier lustrage, la sculpture révèle toute la richesse de ses reliefs. Elle est alors prête à être regardée, appréciée et transmise.